
Les agriculteurs en attente de la prime verte pour un meilleur bilan carbone
|
EN BREF
|
Les agriculteurs, malgré leur motivation à améliorer leur bilan carbone, rencontrent des difficultés à bénéficier d’une compensation financière pour leurs efforts en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES). Bien que des initiatives visant à établir des bilans carbone soient en cours, les paiements incitatifs demeurent rares et les conditions du marché agroalimentaire ne favorisent pas encore la monétisation de ces efforts. Les agriculteurs, comme Christian Grenier ou Pascal Viens, s’efforcent d’implémenter des pratiques durables, mais soulignent le manque de soutien tangible. Des projets, tels qu’AgroCarbone, visent à développer des modèles d’affaires qui permettront aux producteurs de valoriser leurs actions écologiques, mais l’avenir reste incertain quant aux exigences de l’industrie agroalimentaire.
Avec l’urgence climatique qui se fait de plus en plus pressante, les agriculteurs jouent un rôle crucial dans la transition vers une agriculture durable. En effet, le secteur agricole représente environ 10 % des émissions de gaz à effet de serre (GES)
Table of Contents
ToggleLe besoin urgent d’une action collective
Le climat est en danger, et cette réalité impose un changement radical dans les méthodes agricoles. L’agriculture, souvent perçue comme une source de pollution, renferme également des solutions potentielles pour séquestrer le carbone et améliorer l’environnement. Selon Christian Grenier, un producteur de porcs, il est impératif de cesser d’émettre du carbone dans l’atmosphère et de commencer à le stocker dans le sol. Pourtant, les efforts de réduction des émissions, même parmi les agriculteurs les plus motivés, ne sont pas encore suffisamment valorisés dans le système actuel, ce qui crée un sentiment de frustration.
Les enjeux des paiements incitatifs
Malgré l’émergence d’initiatives visant à calculer les bilans carbone des exploitations agricoles et à proposer des solutions d’amélioration, les paiements incitatifs pour les agriculteurs ne sont pas encore généralisés. Les acteurs du secteur, comme Maude Fournier-Farley de Sollio Agriculture, soulignent le désordre actuel, avec une absence de cadre efficace pour soutenir les agriculteurs dans cette transition. Alors que de nombreuses promesses sont faites, les résultats tangibles se laissent attendre, laissant les producteurs dans l’expectative.
Le poids des émissions agricoles
Le secteur agricole québécois doit impérativement réduire ses émissions de GES, qui sont même plus élevées que celles du secteur du bâtiment. Malgré quelques progrès, ces émissions stagnent depuis une vingtaine d’années et sont exacerbées par trois principales sources : la digestion des animaux, la gestion des fumiers et les pratiques de culture. La nécessité d’une démarche efficace et durable est donc plus que jamais ressentie.
Options pour la réduction des émissions
Deux approches principales se présentent pour diminuer les émissions de GES dans l’agriculture : réduire les émissions à la source ou favoriser la séquestration du carbone. La première option est plus directe, mais la seconde offre des avantages à long terme, notamment en améliorant la santé des sols. Marie-Élise Samson, professeure en science des sols, affirme que des sols riches en carbone sont souvent synonyme de bonne santé écologique, contribuant ainsi à la pérennité des exploitations agricoles.
Les objectifs gouvernementaux pour 2030
Le gouvernement du Québec s’est fixé des objectifs ambitieux pour 2030, avec une réduction de 5 % des émissions des sols en culture et de 6 % des émissions de méthane provenant des élevages, par rapport à 2017. Ces cibles sont moins drastiques que celles proposées pour l’ensemble de l’économie, fécondant un sentiment d’inquiétude parmi les agriculteurs qui anticipent les pressions croissantes de l’industrie agroalimentaire. Des entreprises se dotent de cibles exigeantes, mais les agriculteurs attendent encore des mesures concrètes pour soutenir leur transition vers des pratiques plus durables.
La transition à l’échelle régionale
À Hatley, Pascal Viens, un éleveur laitier, exprime son impatience quant à l’absence de retour financier pour ses efforts de réduction des émissions. Il souligne que l’industrie agroalimentaire n’a pas encore clairement communiqué sur les attentes envers les producteurs, créant une incertitude qui freine l’adoption généralisée de pratiques durables. Bien qu’il soit optimiste, il n’en reste pas moins qu’une véritable dynamique doit se mettre en place pour valoriser ces efforts.
La nécessité de modèles d’affaires durables
Face à cette situation, des modèles d’affaires innovants sont indispensables. Chez Sollio, le projet AgroCarbone Grandes Cultures vise à permettre aux producteurs de maïs et de soja d’adopter des pratiques agricoles durables et de monétiser leurs efforts de réduction des émissions. Le projet propose différentes options aux agriculteurs pour qu’ils puissent valoriser leurs droits d’émission, que ce soit par le biais de crédits pour tierces parties ou pour leurs propres ventes.
Le passage à l’action en 2026
Dans le cadre d’AgroCarbone, un « passage à l’action » est prévu d’ici 2026, où 90 producteurs de maïs et de soja implanteront des pratiques agricoles telles que la culture de couverture, celle d’agroforesterie ou encore l’introduction de cultures pérennes. Ces méthodes visent à améliorer le bilan carbone des exploitations tout en répondant aux exigences croissantes de l’industrie.
Marché volontaire des crédits carbone
Les agriculteurs ayant opté pour la vente de crédits carbone pourront se tourner vers un marché volontaire, où de grandes entreprises comme IBM et Shopify cherchent à compenser leurs émissions. Dans ce contexte, Sollio et la Coop Carbone envisagent de créer une entité dédiée à la vente de ces crédits au nom des agriculteurs, facilitant ainsi leur intégration dans ce marché.
Recherches de financement public
Pour soutenir cette transition, le partenariat entre Sollio et la Coop Carbone recherche également un financement public, se tournant vers le système fédéral de tarification du carbone industriel, pour aider les agriculteurs souhaitant vendre des crédits compensatoires. Une demande de subvention de 2 millions de dollars a été déposée pour subventionner ces projets à hauteur de 50 %.
Les défis du marché réglementaire
Au Canada, l’agriculture est largement exclue de la tarification du carbone industriel, sauf pour les carburants qu’elle utilise. Toutefois, des protocoles de crédits compensatoires agricoles existent, mais ils sont peu adoptés en raison de leur coût. Sylvestre Delmotte, consultant agroenvironnemental, note que participer à ces systèmes peut se révéler onéreux, ce qui limite leur attrait pour les producteurs.
Pratiques à coût zéro pour les producteurs
De nombreuses pratiques agricoles peuvent permettre aux producteurs d’améliorer leur bilan carbone sans coûts supplémentaires, voire en générant des profits. Delmotte insiste sur le fait qu’il existe des approches à court terme qui ne nécessitent pas de recourir à des systèmes de crédits carbone complexes. Cependant, pour atteindre des réductions significatives des GES, un système d’incitations financières devra être mis en place.
Prendre le contrôle de l’avenir
Malgré les incertitudes et les urgences qui planent, nombre d’agriculteurs, comme Pascal Viens, sont déterminés à modifier leurs pratiques pour faire de leurs exploitations des puits de carbone. La réalité actuelle met en lumière la nécessité croissante de structures et d’incitations qui récompensent les agriculteurs pour leurs efforts. Il est essentiel que l’industrie agroalimentaire adopte une approche proactive et clair sur ses attentes envers les producteurs pour favoriser une transition réussie vers des pratiques durables.
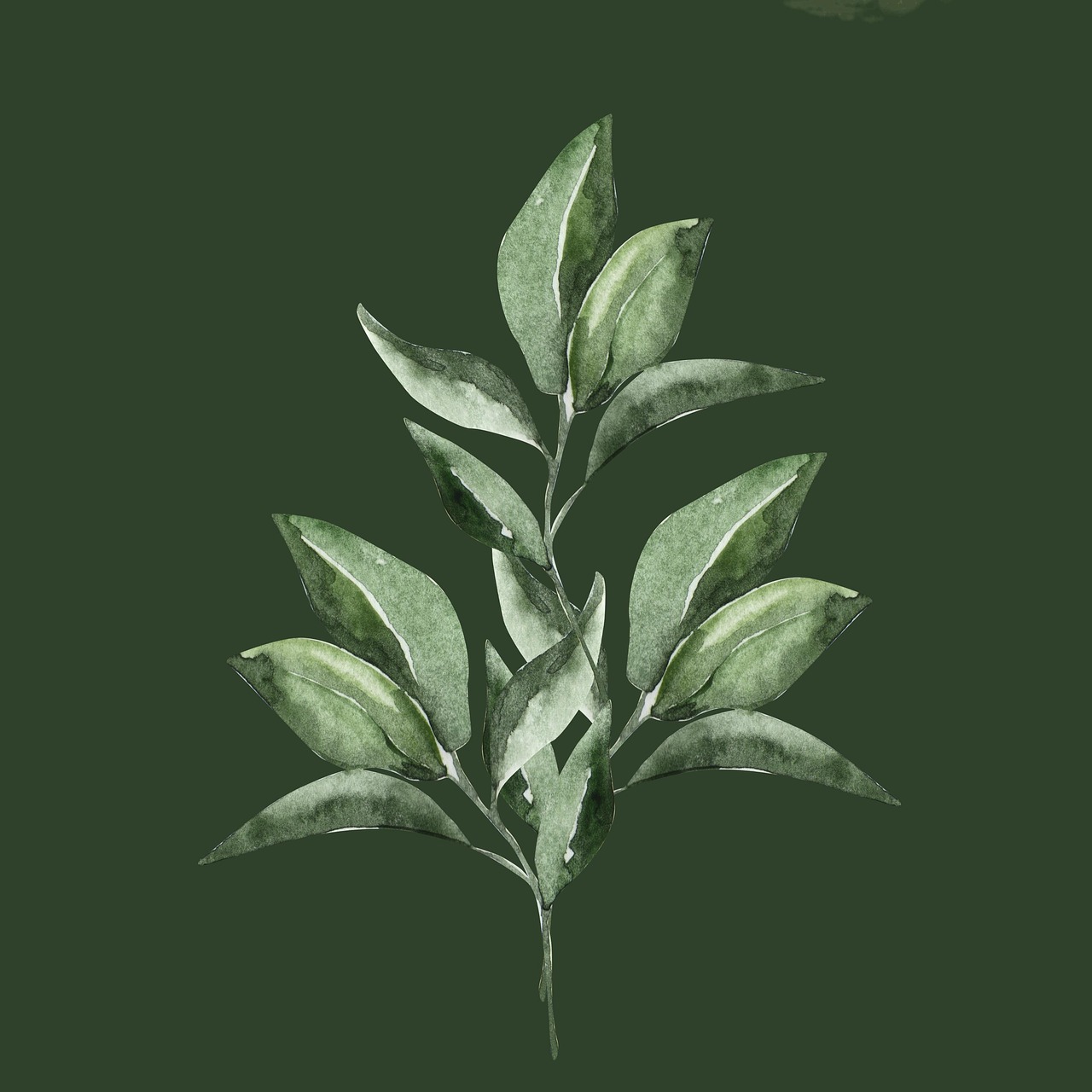
Témoignages d’agriculteurs en attente de la prime verte
« Il est crucial d’intégrer des pratiques plus durables au sein de mon exploitation, mais sans un soutien financier approprié, c’est un véritable défi. J’ai déjà mis en œuvre des méthodes pour améliorer mon bilan carbone, mais il me manque cette prime verte pour en récolter les bénéfices. Je me sens parfois comme si mes efforts étaient invisibles. »
« Chaque jour, je m’efforce de pratiquer une agriculture responsable, car je crois fermement que notre rôle est d’avoir un impact positif sur l’environnement. Malgré mes efforts, je n’ai pas encore reçu la reconnaissance financière qui devrait accompagner mes pratiques. La prime verte représenterait une compensation juste pour mes engagements climatiques. »
« Je passe des heures à analyser mes pratiques agronomiques, à investir dans des technologies pour réduire mes émissions de gaz à effet de serre, mais je me demande si tout cela en vaut vraiment la peine sans un soutien solide. Si la prime verte était accessible, cela m’aiderait non seulement à compenser mes coûts, mais aussi à encourager davantage de producteurs à suivre la même voie. »
« Le manque de clarté autour de la disponibilité de la prime verte freeze ma prise de décision. Je suis prêt à entreprendre des changements fondamentaux pour rendre ma ferme plus durable, mais l’incertitude quant à la prime me met dans une position délicate. Si les agriculteurs comme moi savaient que nous pourrions bénéficier de ce soutien, cela pourrait changer la donne. »
« Ce qui est frustrant, c’est de voir les bonnes initiatives mises en place, mais sans le soutien financier nécessaire qui clôturerait le cycle d’incitation. Pour un agriculteur engagé, la prime verte est l’un des derniers maillons pour transformer mes efforts en résultats tangibles. J’espère qu’une solution sera rapidement trouvée. »

Laisser un commentaire